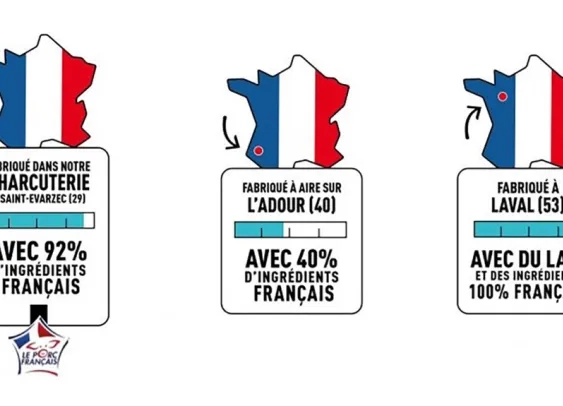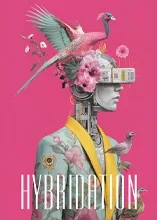« Comment concilier frugalité et création de valeur ? »
19/12/2019Professeur de marketing à l’ESCP Business School, Benoît Heilbrunn est l’auteur de plusieurs livres : le Que sais-je ? sur la marque, Le marketing pour les nuls, L’obsession du bien-être, etc. Pour Le Hub de La Poste, il livre sa vision des enjeux auxquels sont confrontées les marques, autour d’un défi cardinal : arriver à redonner de la valeur aux produits et services que nous consommons.

Quel est pour vous le principal défi qui attend les marques dans les années à venir ?
Benoît Heilbrunn : La nécessité, et le problème, pour les marques dans les années à venir sera de réussir à créer de la valeur économique dans un monde qui va forcément devoir décroître en termes de consommation. La question de la « sustainability », de la durabilité, est fondamentale et va nécessiter de trouver de nouveaux modèles économiques permettant de produire différemment et de consommer moins. Il y a une limite matérielle qui fait que l’on ne va pas pouvoir manger 5 pizzas par jour et avoir 3 scooters chacun !
La question me semble être de savoir comment concilier une approche frugale de la consommation avec la nécessité de créer constamment de la valeur économique, synonyme de travail et d’emploi. C’est un enjeu complexe, car je suis convaincu que de nombreux individus ne sont pas prêts à changer de mode de vie. Même si beaucoup de gens sont persuadés qu’il faut aller vers une consommation plus responsable et plus réfléchie, ils ne changent pas pour autant fondamentalement leurs pratiques. Modifier les comportements nécessite beaucoup d’énergie et de temps. Cela ne peut s’envisager qu’à l’échelle d’une génération. Car toutes les études sur les mécanismes d’acculturation montrent que le temps incompressible pour agir de façon durable sur les comportements est de l’ordre d’une vingtaine d’années.
D’autant que certains objets symboliques empêchent l’évolution de ces pratiques. La voiture électrique est l’exemple par excellence de l’objet de consommation qui ne sert qu’à déculpabiliser les conducteurs sans régler la question de la transition énergétique puisqu’elle ne fait que déplacer les zones de pollution. De la même façon, le fait de remplacer les sacs en plastique par des sacs en papier ne règle aucunement le problème, même si beaucoup sont persuadés que le plastique est le nouvel ennemi à abattre et que le papier et le carton sont parés de toutes vertus. Cela dépend évidemment de la façon dont sont fabriqués ces sacs, avec quelle encre ils sont imprimés, etc.
Se pose donc la question des imaginaires de la consommation mais aussi des pratiques qui leur sont associées. On ne peut avoir d’impact significatif sur la consommation que si on travaille sur ces deux dimensions simultanément. Je suis convaincu que la force de la réglementation et de la pression fiscale est le levier le plus puissant pour conduire à des comportements plus vertueux. La consommation de cigarettes en France a largement décru du fait de la pression fiscale, qui a conduit à une hausse très significative du prix du paquet alors que les campagnes de prévention qui ne visent qu’à changer les attitudes avec des logiques de dramatisation ne servent pratiquement à rien, si ce n’est à gaspiller de l’argent public.
Autrement dit, le prix est le facteur incitatif le plus efficace pour faire évoluer les pratiques. Mais aujourd’hui, l’économie des marques est totalement polluée par la question du prix bas, des soldes, de la promotion. Le marketing a contribué à déconnecter le prix de la valeur. L’industrie du transport aérien a ainsi totalement désancré le prix de l’avion en montrant qu’un vol Paris-Milan correspond au prix de 20 baguettes à la boulangerie. Dans tous les secteurs, il faut redonner de la valeur aux choses pour retrouver un juste niveau de prix. Il faut réarmer la question de la valeur. La valeur économique, et derrière la valeur humaine.
Comment redonner de la valeur à ce que nous consommons ?
La société de consommation s’est construite sur la question de l’identité. Le rôle de la marchandise est d’exprimer qui je suis, ou qui j’ai envie d’être. Autrement dit, la marchandise est une extension symbolique des personnes. Les marques arrivent même à nous convaincre que quelque chose qui peut apparaître inutile revêt en fait une forte utilité sociale. C’est ce système idéologique qu’il faut changer. La marchandise ne doit pas être qu’un miroir narcissique : elle renvoie à une substance, des codes esthétiques que nous partageons mais aussi à des personnes qui ont œuvré pour qu’elle existe, ce qu’on a tendance à oublier totalement devant un rayonnage ou devant son écran.
La valeur va de pair avec la notion d’utilité. Je suis d’ailleurs en train d’écrire un éloge de l’utile pour montrer comment on peut essayer de redonner à l’utilité toute sa place dans le système marchand. Mais l’utilité a été phagocyté par des émotions et du symbolique qui la plupart du temps tournent à vide.
Ce que l’on attend des marques, c’est qu’elles produisent des marchandises, mais aussi du sens. Or le marché est confronté à une crise de la signification et à une montée de l’insignifiant qui ne contribue qu’à produire de la souffrance à mesure qu’elle enrichit des actionnaires peu scrupuleux de la valeur des biens. La plupart des marques ne disent plus rien. Et quand on ne dit plus rien, soit on répète ce que racontent les autres, soit on parle du prix. J’en reviens toujours à cette question du prix, mais elle est pour moi fondamentale.
Une société en soldes est une société qui n’a plus de projet collectif et qui se réfugie dans ce qu’on appelle en économie l’effet d’aubaine. Chacun essaie de trouver la bonne affaire en essayant de tirer avantage d’un système qu’il perçoit comme injuste et prédateur. Cette discountisation de la société crée un ordre marchand dans lequel plus rien n’a véritablement de valeur. Mais il faut bien comprendre que si les biens n’ont plus de valeur, c’est parce que l’on considère que les personnes n’en ont plus guère. C’est pourquoi il faut lutter contre la généralisation de la promotion qui ne fait qu’entretenir un ordre social régi par l’égoïsme et l’instrumentalisation des relations. Les marques ont un rôle considérable à jouer dans cette histoire. Il faut revenir à une question qui a hanté la théologie médiévale et qui est celle du prix juste et de la juste valeur des choses. C’est en acceptant que les choses ont un prix que l’on peut construire des relations sociales plus harmonieuses.
Comment les marques peuvent-elles de nouveau produire du sens ?
Une marque, ce n’est pas qu’une gesticulation sur un marché pour créer du bruit et faire du buzz. Car telle est la vision que nous proposent les tenants de la transformation digitale qui ne s’intéressent finalement qu’à la question de l’activation digitale de la marque.
Ce qui caractérise la marque, c’est un engagement, un contrat, une promesse. Mais les contrats des marques ont perdu de leur crédibilité parce que les marques ont souvent des discours qui ne sont pas en phase avec leurs pratiques. Les marques doivent donc d’abord retrouver une dimension éthique, dans le sens où l’éthique correspond à l’adéquation entre des discours et les pratiques. Ce qui pose la question de sincérité : qu’est-ce qui me permet de croire ce que me raconte une marque ? À mes yeux, quand la marque est adossée à une entreprise, elle est beaucoup plus crédible. Il me semble important de distinguer les marques produits qui ne sont en fait que virtuelles et les marques corporate, ancrées dans le monde physique et réel : elles disposent d’un siège social, de représentants en chair et en os, etc. On a beaucoup plus confiance dans ces marques entreprises. À l’inverse, les marques qui ne sont que des haut-parleurs publicitaires ont perdu toute crédibilité. C’est l’époque Séguéla, et elle est (heureusement) révolue.
La relation entre les marques et les consommateurs a évolué ?
Ce qui ne change pas, c’est la marque qui reste une source d’autorité. La marque imprime un chemin. Une grande marque, c’est un projet, une utopie, une projection imaginaire dans laquelle elle demande à ses parties prenantes de s’inscrire. Mais ce qui a changé, c’est le paradigme de la valeur économique. Avant, on postulait que la valeur économique était créée en amont par des organisations capables d’opérer la différenciation au niveau des produits ou des services. Le client n’était qu’un récipiendaire de la valeur créée par les marques. Mais il y a de moins en moins de différenciation des produits et une augmentation générale des standards dans la plupart des industries.
Désormais, la différenciation ne se fait plus en amont, mais en aval, dans la relation avec les clients. Cela induit l’économie de l’expérience, qui est en fait une économie de la coproduction de valeur. Ce qui caractérise l’expérience, c’est que le client n’est pas simplement consommateur d’une utilité créée en amont, il est coproducteur de cette utilité. C’est ce que l’on appelle la customisation, qui n’est pas la personnalisation. La personnalisation, c’est l’entreprise qui adapte des produits pour les clients, c’est le modèle des options automobiles. La customisation, c’est le client qui est acteur du mécanisme de production de valeur. Ce n’est plus une relation émetteur-récepteur, c’est une relation de discussion, de négociation et de coproduction. C’est pourquoi l’économie des marques nous invite dans le champ réflexif du sens, du dialogue, de la promesse et de la confiance. Il est grand temps que les philosophes s’intéressent aux marques.
VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT AIMER